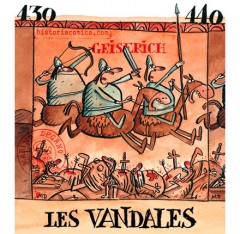Pour Hannah Arendt, le moteur de l'action est in fine la quête d'immortalité. Face à l'éphémère de la vie individuelle, dévorée dans et par le cycle de la nature, laisser une trace qui demeure est une façon de conjurer le futile de sa condition. Par essence donc, l'action ou la geste ne peut se déployer que dans la sphère publique, puisqu'elles ont besoin de témoins. Avec Socrate d'abord, puis le Christianisme ensuite, la "vita contemplativa" (theôria) est venue concurrencer la "vita activa" ; en quelque sorte l'éternel s'est substitué à l'immortel - mais toujours finalement en réaction contre ce qui passe, ne dure pas et s'efface.
L'expression "vita activa" recouvre trois types d'activités : le travail, l'oeuvre, l'action. Le travail pallie les nécessités de la vie biologique. Il est essentiellement consommation, et est le pré-requis de l'action. L'oeuvre est, par sa permanence, ce qui permet à l'homme de situer dans le temps, lui fournit un monde ainsi que les instruments de l'action.
La première partie de son ouvrage va donc se consacrer à la "dialectique" domaine publi / domaine privé, ou l'auteur va tâcher de montrer comment, à l'époque moderne, la vie sociale, avatar de la vie privée, a confisqué l'espace publique.
"La distinction entre vie privée et vie publique correspond aux domaines familial et politique, entités distinctes, séparées au moins depuis l'avènement de la cité antique ; mais l'apparition du domaine social qui n'est, à proprement parler, ni privé ni public, est un phénomène relativement nouveau, dont l'origine a coïncidé avec la naissance des temps modernes.
Ce qui nous intéresse ici, c'est l'extraordinaire difficulté qu'en raison de cette évolution nous avons à comprendre la division capitale entre domaine public et domaine privé, entre la sphère de la polis et celle du ménage, de la famille (...) : sur ces divisions, considérées comme des postulats, comme des axiomes, reposait toute la pensée politique des Anciens.
(...) nous appelons "société" un ensemble de familles économiquement organisées en un fac-similé de famille supra-humaine , dont la forme politique d'organisation se nomme "nation". Nous avons donc du mal à nous rendre compte que pour les Anciens, le terme même d' "économie politique" eût été une contradiction dans les termes : tout ce qui était "économique" [oikia, la maison], était par définition non politique, affaire de famille.
(...) La communauté naturelle du foyer naissait, par conséquent, de la nécessité. Le domaine de la polis au contraire, était celui de la liberté ; s'il y avait un rapport entre les deux domaines, il allait de soi que la famille devait assumer les nécessités de la vie comme condition de la liberté de la polis."
(...) ce que tous les philosophes grecs tenaient pour évident, c'est que la liberté se situe exactement dans le domaine politique, que la contrainte est surtout un phénomène prépolitique, caractérisant l'organisation familiale privée [d'autrui], et que la force et la violence se justifient dans cette sphère comme étant les seuls moyens de maîtriser la nécessité et de se libérer. (...) Cette liberté est la condition essentielle de ce que les Grecs appelaient bonheur, eudaimonia, et qui était un statut objectif dépendant avant tout de la richesse et de la santé.
Le concept de domination et de sujétion, de gouvernement et d'autorité tels que nous les comprenons [cf Hobbes et le Leviathan], d'ordre aussi et de règlement, était senti comme prépolitique, relevant du domaine privé beaucoup plus que du domaine public. La polis se distinguait de la famille en ce qu'elle ne connaissait que des égaux, tandis que la famille était le siège de la plus rigoureuse inégalité.
(...) L'idée que la politique n'est qu'une fonction de la société ; que l'action, le langage, la pensée sont principalement des superstructures de l'intérêt social (...) est un des axiome que Marx reçut des économistes politques de l'époque moderne. Cette fonctionnalisation empêche de percevoir aucune frontière bien nette entre les deux domaines. (...) Depuis l'accession de la société, autrement dit du ménage (oikia) ou des activités économiques, au domaine public, l'économie et tous les problèmes relevant jadis de la sphère familiale [ie les activités de la nécessité] sont devenus préoccupation "collective."
[Sur la notion de bien commun au Moyen-Âge]
Le concept de bien "commun" au Moyen-Âge, loin de dénoter l'existence d'un domaine politique, reconnaît simplement que les individus ont en commun des intérêt matériels et spirituels**. Ce qui distingue de la réalité moderne cette attitude essentiellement chrétienne, c'est moins la reconnaissance d'un "bien public" que l'exclusivisme du domaine privé, où les intérêts privés prennent une importance publique et que nous nommons "société."
(...) Dans la pensée antique, tout tenait dans le caractère privatif du privé, comme l'indique le mot lui-même ; cela signifiait que l'on était littéralement privé de quelque chose, à savoir des facultés les plus hautes et les plus humaines. (...) Evènement historique décisif : on découvrit que le privé au sens moderne, dans sa fonction essentielle qui est d'abriter l'intimité [découvert par Rousseau et les romantiques à l'époque moderne], s'oppose non pas au politique [comme chez les Grecs] mais au social.
(...) La coïncidence flagrante entre l'avènement de la société et le déclin de la famille indique clairement qu'en fait la cellule familiale s'est résorbée dans des groupements sociaux correspondants.
(...) L'essentiel est que la société à tous les niveau exclut la possibilité de l'action [au sens d'exploit ou de geste en qq sorte], laquelle était jadis exclue du foyer. De chacun de ses membres, elle exige au contraire un certain comportement, qui toutes tendent à "normaliser" ses membres (...) à éliminer les gestes spontanés ou les exploits extraordinaires.
(...) Cette égalité moderne, fondée sur le conformisme inhérent à la société et qui n'est possible que parce que le comportement a remplacé l'action comme mode primordial de relations humaines.***
(...) La désagréble vérité, c'est que la victoire que le monde moderne a remporté sur la nécessité est due à l'émancipation du travail, c'est à dire au fait que l'animal laborans a eu le droit d'occuper le domaine public, et que cependant, tant qu'il en demeure propriétaire, il ne peut y avoir de vrai domaine public, mais seulement des activités privées étalées au grand jour. Le résultat est ce qu'on appelle par euphémisme culture de masse. (...) La poursuite universelle du bonheur et le malheur généralisé de notre société sont des signes très précis que nous avons commencé à vivre dans une société de travail qui n'a pas assez de travail pour être satisfaite. Car l'animal laborans, et non pas l'homme de métier, ni l'homme en action, est le seul qui ait jamais demandé à être heureux ou cru que les mortels peuvent être heureux.
Un des signaux les plus visibles (...), c'est la mesure dans laquelle toute notre économie est devenue une économie de gaspillage dans laquelle il faut que les choses [qui pouvaient autrefois relever de la catégorie de l'oeuvre] soient dévorées ou jetées presque aussi vite qu'elles apparaissent dans le monde pour que le processus lui-même ne subisse pas un arrêt catastrophique.
Note : pour Aristote, l'homme est un animal politique (zôon politikon) ; pour le latin, il est un animal social (animal socialis cf Sénèque et Thomas d'Aquin : homo est naturaliter politicus, id est socialis). Hannah Arendt parle, au sujet de cette dérive sémantique, de substitution du social au politique.
** Hannah Arendt a une compréhension très restrictive du bien commun dans la doctrine catholique. Pour cette dernière, le terme "bien" est à prendre dans une acception disons transcendantale ; un bien à la manière platonnicienne. En ce sens l'expression n'est pas équivalente à intérêt commun ou général : un intérêt commun n'est pas forcément un bien. Par exemple la santé est un bien, et parce qu'elle concerne l'individu et la société, elle peut-être appelée un bien commun. En revanche, si une société décide que l'intérêt général commande la liquidation des vieux, des incurables et des malades mentaux, en aucun cela ne se peut se faire au nom du bien commun.
*** Cela explique peut-être le retour de bâton post-moderne : en réaction, l'on essaie de faire passer pour norme ce qui est anti-conformiste, qui devient une fin en soi. Cela s'appelle tomber de Charybde en Scylla.